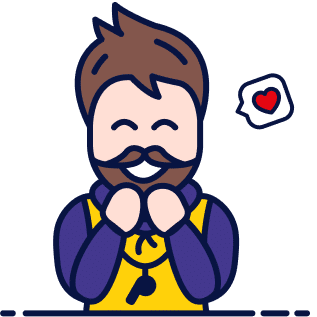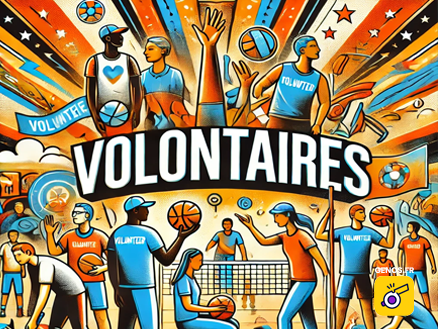AdministratifCommunication
Ici, nous te proposons de nombreux articles, conseils, interviews, astuces sur la pratique sportive, la gestion de clubs, l’entraînement, conseils nutritionnels, astuces pour gérer son temps etc.
Tu l’as compris, sur tout ce qui concerne le sport mais pas que … Tu trouveras aussi ici les “news” à propos de l’application.